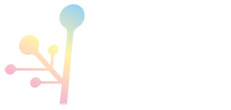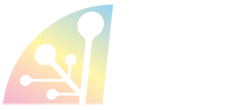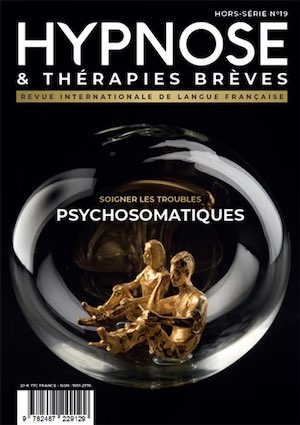L'hypnose thérapeutique, de quoi parle-t-on ?

Dr ERIC BARDOT, Dr JULIEN BETBÈZE ET STÉPHANE ROY.
Un échange croisé, nourri et stimulant autour de l’hypnose thérapeutique, une réflexion à trois voix qui se déploie et réunit Éric Bardot, Julien Betbèze et Stéphane Roy...
Stéphane Roy : Commençons avec cette question : comment pourrions-nous comprendre cet apport essentiel de l’hypnose dans le processus thérapeutique ?
Eric Bardot : Oui, c’est une question essentielle, en particulier dans les troubles psychosomatiques. Lorsqu’un sujet se sent étranger dans le monde, l’entrée dans une transe de dissociation rend possible la conservation de son intégrité. La transe, grâce à sa dimension protectrice, va lui permettre de comprendre qu’il peut garder sa liberté et traverser l’angoisse s’il accepte les effets sensoriels de dissonance de ce monde. A ce moment-là, des réponses vont pouvoir émerger et la liberté s’enrichir. Faire cette expérience est au centre de l’enseignement de Jean Godin et de Milton Erickson.
Julien Betbèze : Effectivement, Jean Godin a joué un rôle majeur pour saisir ce lien essentiel entre hypnose et liberté. C’était aussi la base de l’enseignement d’Erickson, comprendre la transe comme lieu d’expérimentation de la liberté dans la relation. Or dans notre culture technique, la difficulté pour comprendre l’apport de l’hypnose tient au fait que la relation est souvent pensée comme contraire à la liberté. Nous entrons ainsi dans un paradoxe entre une expérience humaine, avec un processus dissociatif permettant de préserver la dimension de créativité du sujet, son humanité, sa liberté, et une vision dominante pour qui l’hypnose est l’expression d’un pouvoir, d’une mainmise sur l’autre. La transe est une des racines de la liberté, elle permet de faire une expérience de liberté, même quand il y a la dissonance. Et cette dissonance est très fréquente. Ce premier point important à noter est le paradoxe entre liberté et hypnose lorsque la coopération n’est pas pensée. On retrouve ce paradoxe lorsque l’on réduit l’hypnose à la suggestion, cette dernière serait un moyen de prendre pouvoir sur l’autre, de le manipuler, même pour son bien.
E.B. : L’expérience de liberté, c’est de pouvoir être en lien avec son intégrité, avec la personne que je suis à l’intérieur de moi. Or cette personne ne peut s’exprimer que dans l’interaction entre ma propre singularité et celle de l’autre. L’appartenance du sujet à un groupe intime permet à chacun de valider son intégrité en lien avec des expériences partagées. C’est cela qui permet l’émergence d’un sens. De mon point de vue, les mots qu’on va mettre sur cette expérience partagée, en retour, permettent de lui donner sens, de la rendre visible.
J.B. : Tu soulignes le lien entre le sens et le partage, c’est-à-dire que la liberté n’est pas une autodétermination dans le vide, elle émerge d’une expérience de partage, elle est le signe d’une intentionnalité partagée. Cette liberté est alors vécue dans la relation humaine, elle est incarnée, elle n’est plus réduite à une représentation mentale. Ainsi quand le sujet est dans un processus de transe, si la dissonance est présente, il reste en contact avec ce qu’il y a eu de vivant dans ses relations et donc il va pouvoir par la suite se ré-associer et habiter son corps. Sinon il resterait bloqué par les effets de la dissonance. Pour construire librement à nouveau des expériences qui font sens, il est donc essentiel de s’appuyer sur le processus actif de la transe, à savoir l’autonomie relationnelle, c’est-à-dire penser la liberté dans la relation, et non pas contre celle-ci.
E.B. : Ceci m’évoque Puységur, qui travaillait avec des transes profondes. Un jour, il propose à son patient Victor de faire quelque chose contre son gré, et à ce moment-là celui-ci lui dit : « Là, je sais que vous essayez de me manipuler. »
J.B. : C’est pour cela que l’hypnose et le travail de Puységur sont à l’origine des psychothérapies modernes dans le sens où elles ont du sens et ne sont pas des logiques de disciplines ou de manipulation. Leur but est de permettre à l’autre de pouvoir exister dans la relation, alors que celle-ci est fréquemment perçue comme non fiable.
E.B. : La question est de savoir comment utiliser les phénomènes hypnotiques pour travailler en thérapie au niveau des vécus dissociatifs qui coupent la personne entre son expérience et le monde, entre son expérience et l’autre.
J.B. : L’hypnose est la manière dont nous nommons la transe dans notre culture ; elle est une des modalités de la vie. On voit bien que tout processus de créativité ou toute œuvre culturelle a des effets parce qu’elle permet la transe : si lire un livre, voir un film, ne nous met pas en transe, c’est que le livre ou le film sont des objets sans valeur. Le sens d’une œuvre passe par sa capacité à activer ce processus de transe, c’est une ouverture qui nous fait percevoir quelque chose de vivant au-delà des objets, et là tout à coup quelque chose émerge. On va travailler avec ce que l’on observe au niveau des phénomènes hypnotiques qui sont là naturellement : ils ont du sens. Et penser ce sens par rapport au sentiment d’unité, en lien avec l’expérience d’affect partagé, c’est cela qui donne sens à la sensorialité et permet de reprendre des initiatives pour co-construire une histoire vivante.
E.B. : Oui, pour moi la base du développement de notre personne passe par le sentiment d’unité. On voit bien comment dans les expériences traumatiques, c’est cette expérience d’unité qui n’est pas en place, elle est impossible. L’objet premier de l’hypnose comme processus est d’intégrer nos expériences de vie de manière corporelle pour pouvoir accéder à une expérience d’unité.
La première expérience d’intégration est l’expérience d’unité, elle se réalise d’abord au sein d’une expérience de transe. C’est cette expérience d’unité qui va créer l’expérience de liberté ; et c’est cela qu’on va travailler dans la transe. A ce moment-là, tout ce qui est construction des représentations va se mettre à distance, et la personne va pouvoir trouver, retrouver ou découvrir le lien avec cette expérience d’intégrité et de liberté qui fait sens. La difficulté lorsqu’on parle d’hypnose, c’est que l’on met sous un même mot la technique, l’expérience et le concept d’hypnose. L’hypnose c’est vraiment rejouer cette expérience d’association et de réassociation, comme elle se joue dans l’expérience première de la relation mère-nourrisson ; l’autre va ainsi être l’expression de la relation au monde et de l’expression de la dimension d’appartenance à l’humain. Et c’est l’expérience de cette relation de confiance dans le soutien qui est fondamentale pour faire une expérience d’unité. Ainsi le nourrisson fait son expérience d’unité dans la relation au corps de sa mère.
J.B. : C’est parce qu’il y a ce soutien de base dans la relation mère-enfant que quelque chose tient et que le sujet peut se construire.
E.B. : Oui, et les fondations ne sont pas des fondations intellectuelles, ce sont des fondations physiologiques. L’hypnose est cette enveloppe qui va développer la contenance, cette enveloppe qui va permettre à chacun de sentir et de vivre sa singularité dans l’expérience partagée avec l’autre en position inconditionnelle d’accueil et de soutien. Et c’est dans cette expérience-là que chacun va faire l’expérience de vie qui va mener à cette expérience de liberté. Nous sommes ici très loin des propos d’Hippolyte Bernheim qui a réduit l’hypnose à la suggestion et qui a rendu l’hypnose incompréhensible. Effectivement, pour que la suggestion-séduction-fascination agisse, on n’a pas besoin de l’hypnose.
J.B. : Comprendre que l’hypnose est une modalité de la relation vivante, elle-même condition de la singularité, est indispensable pour saisir la pertinence de notre travail. C’est parce que la relation est en place, que la subjectivité peut émerger. Pour Bernheim, il n’y a pas cette enveloppe, il y a toujours deux individus séparés qui doivent avoir une influence l’un sur l’autre en terme de comportement, mais cela ne permet pas l’accès à une singularité qui fait sens dans une expérience de partage. Si la condition de la constitution relationnelle du sujet n’a pas été posée par Bernheim, elle a été enfin posée par Erickson.
E.B. : C’est très important car à partir du moment où l’on pense à partir de la technique, et que l’hypnose est définie comme une technique protocolaire, ça veut dire que la technique doit produire toujours les mêmes effets. Et cela permet ne jamais questionner la personne. C’est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec Bernheim qui réduit la psychothérapie à la suggestion. La seule suggestion sans hypnose qui fonctionne s’appelle la persuasion. Et pour qu’elle tienne, cela nécessite que la personne qui subit la persuasion s’approprie les intentions de l’autre.
S.R. : Oui, cela m’évoque la manière d’utiliser l’hypnose selon deux modalités : soit il s’agit de renforcer de manière suggestive des positions identitaires et donc victimaires, soit au contraire de conduire le sujet vers un degré de liberté supplémentaire qui implique d’intégrer l’autre.
J.B. : Ainsi, pour que la vie puisse revenir, il faut travailler avec cette deuxième modalité de liberté supplémentaire, de singularité, d’accueil inconditionnel, avec cette dimension d’enveloppe en tant qu’expérience humaine fondatrice. Si on ne rejoint pas ce type d’expérience, on reste pris dans les mondes identitaires, qui sont des mondes très mortifères, parce qu’à la fin il n’y a personne, il n’y a plus que des représentations d’identités. E.B. : Et nous savons bien que lorsque nous sommes dans cette expérience humaine, en lieu et place du désespoir, c’est l’émerveillement qui vient. S.R. : S’approprier l’intention de l’autre, c’est ce que l’on retrouve dans la question du traumatisme où l’intention de l’autre est injectée.
E.B. : Effectivement, rien ne ressemble plus à une relation hypnotique qu’une relation d’emprise, sauf qu’il faut se rappeler que si l’emprise est là, c’est parce que la relation d’emprise est déjà présente dans l’intention. Dans l’intention de celui ou celle qui cherche à mettre sous emprise, il ou elle ne s’adresse pas à n’importe qui : il ou elle va savoir repérer, de manière intuitive, la personne qui va être suggestible, celle qui va pouvoir entrer dans une relation de dépendance. On sait bien qu’Erickson s’est opposé aux échelles de suggestibilité, qui sont en fait des échelles de suggestion pratiquées de façon répétée dans l’hypnose de spectacle. Mon expérience me montre qu’au fur et à mesure que se déroule le travail thérapeutique avec l’utilisation des phénomènes hypnotiques, lorsque les sujets se reconnectent à leur propre intégrité, la suggestibilité est de moins en moins opérante.
J.B. : Ça me paraît très juste : c’est lorsque que le sujet a pu se reconnecter à des relations vivantes qui le soutiennent que le changement peut intervenir. C’est à ce moment que le sujet échappe au pouvoir de l’autre, aux relations de maltraitance.
E.B. : Voilà, l’abuseur va percevoir les effets de dissonance lorsque le sujet, sans relation de soutien, est enfermé dans le scénario de seul-au-monde.
S.R. : Si je comprends bien, la perception de ces effets de dissonance peut, en fonction des intentions du thérapeute, aussi bien basculer du côté de de la maltraitance, ou du côté thérapeutique.
E.B. : Nous sommes en tant qu’êtres humains situés dans des processus d’influence réciproque. Et donc la question est : avec quelle intention allons-nous prendre appui sur les processus d’influence réciproque ? Et tant que l’intention est unilatérale et n’est pas partagée, l’action n’amènera pas de changement. Ce qui va orienter vers la réassociation, ce n’est pas la technique en soi, mais la qualité de l’intention partagée, c’est-à-dire une mise en mouvement où la liberté va faire sens.
J.B. : Oui, les valeurs n’ont de sens que si elles sont en lien avec une expérience d’intention partagée. Et lorsque François Roustang nous dit qu’« avec l’hypnose, il n’y a pas d’intention », il faut comprendre « d’intention non partagée ». Quand l’intention est partagée, l’intuition et la spontanéité s’installent et facilitent la mise en mouvement.
E.B. : Le premier travail de rencontre va porter sur « comment construire un espace-temps où les intentions vont pouvoir se rencontrer et une forme commune émerger ? ». Et cette forme concerne ce vers quoi la séance d’hypnose va aboutir. Comme dit le proverbe, il n’y a pas de bon chemin pour qui ne sait pas vers où il va aller. Quand l’intention est partagée, les processus d’anticipation se mobilisent, et le corps réalise naturellement l’action par activation des processus idéo-dynamiques. Et les techniques hypnotiques vont être ainsi les outils au service des thérapeutes pour permettre et faciliter ce processus naturel. Le rôle du thérapeute n’est donc pas « d’agir sur », mais de lever les obstacles de ce processus, que l’on l’appelle « transe », « extase », « processus de conscience modifiée », qui est notre manière de vivre et de nous connecter à notre intégrité, c’est-à-dire d’aller chercher la vie qui est en nous.
J.B. : François Roustang parle de l’intention comme de l’intention intellectuelle, elle est pour lui en relation avec des moyens d’action en vue d’une fin, tandis qu’avec l’hypnose c’est l’inverse, l’intention intellectuelle est absente, c’est la fin qui est première. En thérapie narrative, Michael White utilise une vision affirmative de l’intentionnalité qui relie la fin de l’action à une forme de l’intention partagée.
Vous cherchez une formation
en HYPNOSE THERAPEUTIQUE ? 
Vous recherchez une formation en
HYPNOSE MEDICALE ?
- Médecines Complémentaires et Alternatives
- Hypnothérapie
- Affichages : 617