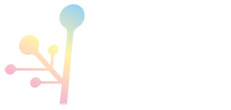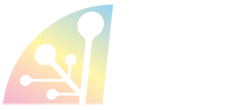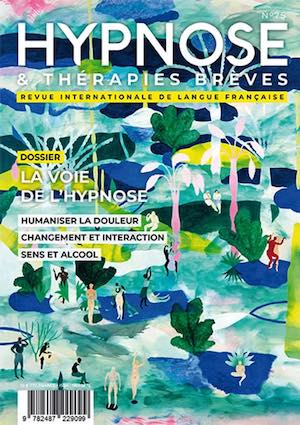Alcool et dépendance. Revue Hypnose et Thérapies Brèves 75.
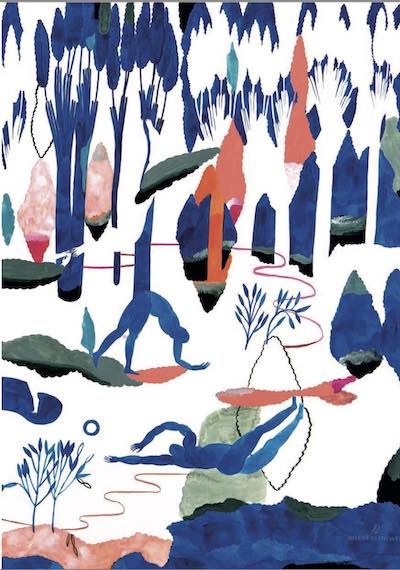
Souffrant d’une addiction à l’alcool, ce patient remonte aux sources d’un passé soumis au règne des punitions. Son traitement par l’hypnose, pour ramener du sens à sa vie, a fait surgir les figures de Lucky Luke et Jolly Jumper et la poésie de Sully Prudhomme...
Le retour de "puni de tout".
J’arrive à la clinique, je rejoins mon bureau et derrière moi j’entends les mots suivants : « je vous attendais ». Cette voix ne m’est pas in- connue, je me retourne et je reconnais immédiatement le patient en train de m’interpeller. C’est « Monsieur puni de tout ». Son identité nominative ne me reviendra qu’un peu plus tard. Et il ajoute les mots suivants, tout aussi inattendus : « qu’est-ce qu’on fait maintenant ? », comme si nous nous étions vus la veille...
alors que notre dernière rencontre remonte à un peu moins de deux ans. Agé de 43 ans aujourd’hui, Guillaume, appelons-le ainsi, en est à sa deuxième cure de désintoxication à l’alcool. Je l’ai rencontré une première fois à la cure précédente, soit pas tout à fait deux ans plus tôt.
A l’époque, nous avions tout juste commencé un travail thérapeutique, prématurément interrompu en raison d’une problématique de santé ayant conduit à une longue interruption de mon activité professionnelle. Guillaume m’avait relaté à l’époque une anecdote, gravée dans ma mémoire, j’ignore si c’est parce qu’elle m’avait fait sourire et/ou parce que j’avais pressenti que cela pouvait constituer une information clé à prendre en compte dans la manière de l’accompagner. Ses amis, lorsqu’il était adolescent, lui avait donné le surnom « puni de tout ». Guillaume, dès son plus jeune âge, semblait effective- ment accumuler les punitions que lui don- nait son père. Ce dernier contractualisait par écrit avec Guillaume les tâches à effectuer, les conduites à tenir et prenait soin d’y faire figurer les sanctions qui seraient appliquées en cas de non-respect.
En parlant de sa mère, Guillaume évoque qu’elle aussi était « rentrée dans le rang » et n’a pas le souvenir qu’elle ait impulsé un autre mode de relation avec ses enfants. Ses amis avaient remarqué que les menaces de sanctions étaient assez récurrentes et s’en étaient amusés en lui donnant ce drôle de surnom qui semble ne pas l’avoir véritablement quitté. Guillaume décrit une envie impérieuse très tôt de s’arracher de cette condition et de conquérir sa liberté par tous les moyens, du moins chaque fois que l’opportunité lui en était offerte. Sans s’attarder sur des éléments biographiques, il fut amené à s’éloigner du clan familial en vue d’entreprendre des études. Il profita alors pleinement de la vie étudiante dans ce qu’elle offre de liberté et au moment de sa rencontre avec l’alcool, il décrit une consommation excessive quasiment immédiate. Assez rapidement, et parce que nous avons coutume en thérapie brève d’interroger sur la fonction ou l’intention d’un comportement plutôt que sur sa prétendue cause, il verbalise que l’alcool lui permet de s’évader et d’expérimenter un sentiment d’insouciance. Jeune adulte, il devient sans surprise dépen- dant de l’alcool bien qu’il s’astreint à ponctuer son parcours de périodes d’abstinence, plus ou moins respectées, les propos restant assez vagues à ce sujet. A ce jour, il exerce des fonctions commerciales mais il a été récemment congédié en raison d’absences répétées et de prises de liberté vis-à-vis du règlement. Il y a un paradoxe assez stupéfiant entre l’apparence assez sobre pour ne pas dire conventionnelle de ce patient, et une propension à transgresser les règles en général, avec un certain panache, y compris au sein des établissements de soins qu’il a fréquentés. Il ne rate presque aucune occasion pour faire quelques traits d’humour, en étant toutefois peu expressif. Guillaume a une sœur légèrement plus jeune que lui, qui, à ses dires, aurait une addiction à l’alcool plus sévère que la sienne. Il a aujourd’hui un adolescent de 15 ans dont il a la garde partagée depuis la séparation avec son épouse il y a une dizaine d’années.
Outre un attachement très fort, il décrit une relation de grande qua- lité avec son fils, pleine de spontanéité dans certaines situations et de pondération dans d’autres, sans aucun équivalent, précise-t-il, dans ses expériences relationnelles dont il a le souvenir. Lorsqu’il parle de son fils, il lâche que c’est comme un frère, avant de se raviser parce que la comparaison lui semble maladroite. Il ne résiste pourtant pas à l’envie d’abonder davantage dans cette perspective en évoquant que sa situation d’aujourd’hui serait tout à fait différente s’il avait su compter sur une relation aussi belle. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus tard, tant cette exception fait figure de « preuve vivante » qu’une alternative au vécu de maltraitance soit déjà en germe et puisse donc être étoffée. Depuis quelques années, Guillaume a une relation affective assez stable mais il décrit de grandes difficultés à s’engager, de peur de renoncer à une liberté dont il reconnaît pour autant ne pas savoir quelle direction lui donner. Au niveau professionnel, bien qu’il ait eu une expérience relativement stable, il lui faut, au moment d’investir un nouvel emploi, disposer d’une ou même plusieurs portes de sortie. Guillaume veut se préserver de tout sentiment d’enfermement. Il est en mesure de s’adapter avec une certaine facilité à un cadre et il envisage presque sur le même temps la manière de s’en affranchir.
Nous avons là une configuration familiale où l’affect est clairement écorné. Le sentiment d’amour est peu palpable, pour ne pas dire absent. Certes Guillaume a un désir d’autonomie mais ce dernier ne se construit pas sur un projet mais davantage en réaction à une situation dont il veut s’éloigner. Guillaume a des ressources indiscutablement, voire des facilités intellectuelles manifestes, mais quand il s’agit d’approcher de manière sensible la possibilité de se projeter dans quelque chose qui fait sens, il semble comme anesthésié. Il se dit tout à fait conscient que ses alcoolisa- tions ne le mèneront nulle part et n’entrevoit en même temps aucun projet de vie susceptible de conférer à son existence une densité suffisante et de conduire à une modification substantielle de son rapport à l’alcool. Guillaume semble vouloir tromper la morosité de son quotidien. Il prétend n’avoir aucune dé- finition du bonheur mais il ressent le besoin de s’échapper le plus souvent possible de son quotidien pour arpenter les terrains de golf, ce qui est sans nul doute son activité favorite. Il apparaît que travailler sur la définition d’un objectif comme préalable à l’entrée en thérapie ne fournira que peu d’éléments. En revanche, interroger la qualité de la relation thérapeutique en tant qu’espace suffisamment sûr dans laquelle repositionner, le moment venu, un projet existentiel semble plus adapté.
On y retrouve le premier levier « le thérapeute adopte une posture sécurisante ». Nous avons en effet pris le temps d’installer la relation thérapeutique, d’apprécier la qualité de l’alliance et nous avons en- suite travaillé à la création d’une expérience sécure « renforcée » en nous appuyant sur la modélisation développée par la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR). Cette dernière comporte un avantage substantiel de notre point de vue dans une ap- proche systémique, à savoir qu’elle balaie les différents niveaux relationnels. Un vécu d’apaisement qui étonne Guillaume s’installe alors. Puis quelque chose semble faire obstacle à la généralisation de ce vécu, à savoir la remémoration d’un épisode de vie que le patient juge pourtant anecdotique en apparence. Guillaume relate que lui-même et sa sœur avaient interdiction formelle d’allumer la télévision que les parents soient présents ou absents du domicile. La règle était parfaitement respectée au rez-de-chaussée mais il y avait également une télévision dans la chambre parentale au deuxième étage. Guillaume, quand il lui semblait que « le terrain était à découvert », rejoignait la chambre parentale pour allumer la télévision. Il témoigne à la fois de l’excitation et de la peur entremêlées à braver cet interdit. Nous consi- dérons dès lors qu’il s’agit là d’une illustration d’une autonomie relationnelle mise à mal (1). Dans le cas présent, la règle n’est pas vécue comme une limite mais comme une censure qui disqualifie la relation, en ne permettant pas d’entrevoir les intentions positives liées à cette interdiction. L’expérience de liberté, quant à elle, est vécue de façon angoissante mais la jouissance à la conquérir condamne Guillaume dans une forme d’errance « joyeu- sement déprimante ». Les conduites addictives ont ce mérite de mettre cette dernière temporairement en suspens. Ayant remarqué une certaine disponibilité...
David Vergriete Psychologue, pratique les thérapies brèves et l’hypnose au sein du service Addictologie de la clinique de la Mitterie située à Lomme (Nord). Titulaire d’un DU Addictions comportementales Université Paris Sud, certifié HTSMA. Formateur au DU d’Hypnose médicale de la Faculté de médecine de Lille, enseigne également auprès de l’Espace du possible à Tournai et de Formation Evolution Synergie à Avignon.
NOTES
1. Betbèze J., « Autonomie relationnelle », . Hypnose & Thérapies brèves ., Hors-série n11, mars 2017.
2. A travers ce type de suggestions, je fais référence aux métaphores dites d’activation détaillées dans l’article « Vide et addictions » de la revue . Hypnose & Thérapies brèves . n 57 (Mai/Juin/Juillet 2020).
Revue Hypnose & Thérapies brèves n°75 version Papier
N°75 : Nov. / Déc. 2024 / Janv. 2025
Les interactions pour favoriser un changement.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°75 :
Si l’hypnose ericksonienne est une hypnose relationnelle, cela implique que le lieu d’habitation du corps soit la relation. Ainsi, lorsque la relation est vivante, le sujet vit une expérience corporelle où spontanément il accueille ses ressentis sensoriels, est en capacité de prendre des initiatives. En ce sens, le travail sur les interactions est primordial pour favoriser un changement.
. Guillaume Delannoy, dans un article très pédagogique, nous montre à partir de quatre situations cliniques – douleur psychosomatique, jalousie entre sœurs, obésité morbide, angoisse de mort et tics nerveux – comment la modification des interactions permet l’activation des processus de réassociation. L’auteur, avec la participation de Vania Torres-Lacaze, souligne l’importance du travail de co-thérapie pour rendre possible le changement.
. Delphine Le Gris nous raconte l’histoire de Sophie dont la vie est parcourue de relations insécures et qui cherche une solution à son problème d’insomnie. Elle nous décrit une séance d’hypnose avec un coffre-fort fermé à clé qui va lui permettre d’y enfermer ses ruminations et de retrouver un sentiment de protection.
. L’importance de l’humour est au centre du texte de Solen Chezalviel, dont la créativité ouvre une petite lumière dans un monde empli de noirceur.
. David Vergriete, avec sa grande expérience de prise en charge des addictions, évoque, à travers le cas de Guillaume souffrant d’alcoolisme chronique, l’importance de la qualité relationnelle et la nécessité d’interroger la question du sens et de la trajectoire existentielle.
. Introduction Espace Douleur Douceur.
. Dans l’espace ''Douleur Douceur'', Fabrice Lakdja et Gérard Ostermann nous parlent de la remédiation antalgique. Le retraitement de la douleur vise à réattribuer la douleur à des voies cérébrales réversibles et non dangereuses et à considérer la douleur comme une fausse alarme et non comme la signature de lésions tissulaires.
. Maryne Durieupeyroux nous emmène à la rencontre de Pablo, jeune homme pris en charge en soins palliatifs pour des métastases multiples. Elle utilise le ''gant magique'' et évalue les réactions du patient au fur et à mesure de son travail.
. Charles Joussellin et Gérard Ostermann : Accueillir, écouter et favoriser un effort de narration doivent être au centre de nos prises en charge. La question du sens, de l’anthropologie, sont indispensables à nos métiers de thérapeutes.
. A partir d’un atelier avec Roxanna Erickson-Klein, Evelyne Josse montre l’importance des métaphores pour focaliser l’attention du patient et remettre la vie des sujets en mouvement. Roxanna utilise la métaphore de l’embarquement à bord d’un train pendant qu’Evelyne se laisse bercer par les mots et, dans cet état de transe, développe sa créativité. Les métaphores nous incitent ainsi à reconsidérer, réélaborer et réévaluer nos expériences en ouvrant de nouvelles possibilités pour redevenir auteurs de nos vies.
. Jean-Marc Benhaiem nous décrit la manière dont il comprend la logique de l’intervention en hypnose. Il nous parle des trois modes d’être : mental, sensoriel et confusionnel. Le déséquilibre entre ces modes s’installe au sein des relations dysfonctionnelles, lorsque le sujet, pour se défendre, privilégie un mode au détriment des deux autres. A travers plusieurs situations cliniques, il fait le lien entre l’excès du mental et le contrôle excessif. Pour le thérapeute, il s’agit d’aider le patient à passer de la rigidité à la fluidité, en retrouvant un corps présent.
Les rubriques :
. Sophie Cohen : Christelle et la trichotillomanie en question
. Adrian Chaboche : La présence
. Stefano Colombo et Muhuc : Voyage
. Psychotrauma, PTR, EMDR
. Sylvie Le Pelletier-Beaufond : Le souffle de la guérison au Népal
. Livres en bouche
. Résumé
- Médecines Complémentaires et Alternatives
- Addictions - Conduites Addictives
- Affichages : 2338